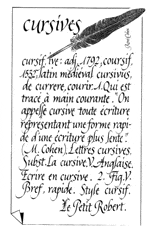"Je suis née dans une famille italiano-russe où le maître mot Un entretien avec Dominique Lombardi,
- 1 -
Entre stylisme, journalisme et cinéma Dominique Lombardi : Oui… Autour de 1980, j'ai créé Galène Roucas, une marque de stylisme, ayant été à bonne école avec des parents plasticiens, et aussi parce que j'aimais dessiner ! J'aimais les vêtements originaux. Même si je ne savais pas coudre, j'ai appris sur le tas, je me suis fait des vêtements, ça a plu à des copines.
L'ouverture vers l'humanitaire D.L. : L'écriture, la seule matière scolaire où j'étais forte, a toujours été très importante pour moi. J'avais de bonnes notes mais qui baissaient à cause de l'orthographe. On me disait : "Quand on fait des fautes d'orthographe, c'est qu'on est inculte ou qu'on ne lit jamais !". Ce n'était pas mon cas, mais bon… J'ai continué avec des livres. En 1994, 1–2–3 Savine (Éditions de l'Aube), un livre sociologique pour la mairie (DSU), mais réalisé par une personne qui "ne fasse pas peur" aux personnes interviewées. Il s'agissait d'écrire avec les habitants de la Cité de la Savine avant la démolition de plusieurs bâtiments. C'étaient des femmes de diverses communautés qui me racontaient leur arrivée dans ces immeubles. La plupart venaient de quartiers très pauvres, voire de bidonvilles. D'un coup, La Savine, pour elles, c'était le bonheur : salle de bain, chauffage… Mais, contrairement aux sociologues, moi je re-rédigeais et j'en faisais des nouvelles. Le but était que les histoires de ces gens deviennent les histoires d'autres gens, une transmission de récits, pas comme une étude savante. Les textes étaient relus à ces personnes et souvent c'était : "Non, la tapisserie n'était pas verte mais bleue !". C'était important pour elles. Puis, en 1997, il y a eu Cuisines sur rues (1997 - Éd. Bureau des compétences et désirs). La commande était de faire une étude sociologique de la Délégation aux Droits de la femme mais en prenant le parti d'en faire des nouvelles. Douze histoires, douze femmes, douze origines différentes : Russie, Comores, Algérie, Arménie… Une même question : "Racontez-moi une histoire d'un jour de fête avec les recettes de cuisine qui vont avec". Les jours de fête ? Baptême, mariage, Noël, l'Aïd ou le retour de quelqu'un que l'on n'a pas vu depuis longtemps. Les recettes comoriennes étaient les plus compliquées parce que tu ne trouves pas les ingrédients ! Elles disaient : "tu remplaces ça, par ça", oui, mais c'est quoi "ça ?" En 2000, C'est la faute au soleil (Éd. Bureau des compétences et désirs), à la demande de la bibliothèque de Peynier pour un travail avec le club 3ème âge et la Fondation de France. Le procédé était le même : douze à quinze personnes du club me racontaient des moments importants de leur vie entre 1932 et 1952 et encore avec les recettes de cuisine qui vont avec (parce que moi, j'aime bien manger) ! Donc il y avait les pieds-paquets de la Libération, la visite du ministre à l'école pendant le Front Populaire, etc. Fili : C'est la petite histoire dans la Grande… D.L. : C'est ce qui me plaît dans tout ce que j'ai fait. Ce sont les choses que les gens ont perçues qui n'ont pas de rapport avec la Grande Histoire, sauf qu'ils se sont pris la Grande comme un mur dans la figure et je mets en forme comment finalement s'en accommodaient. Par exemple, on apprend à manger de l'écureuil. Des lecteurs m'ont dit : "C'est un scandale". Oui, mais comment expliquer que pendant la guerre, on mange ce qu'on a sous la main ?
Partir à la rencontre du monde D.L. : Le livre suivant s'est appelé Le quatrième cerveau (2003 - L'écailler du sud). C'est un roman noir, je l'ai écrit suite à un voyage en Bosnie. J'y reviendrai. Un jour, je participe à un salon du livre sous des platanes, près d'Aix, où il n'y avait personne. J'étais avec Jacques Bonnadier (journaliste, reporter, écrivain) et Philippe Carrese (réalisateur, romancier, compositeur, dessinateur de presse) que je ne connaissais pas. Tous les trois, on a passé une bonne partie de la journée à ne rien faire. On a sympathisé, rigolé. J'ai parlé de ce que j'aime. J'ai aussi parlé de la guerre qui est une préoccupation récurrente dans mon travail. Avec Philippe, on en est venu à se dire : "Si on faisait un scénario et un film ?" C'est comme ça que ma carrière cinématographique a commencé. Malaterra a été le premier scénario écrit ensemble. Personne n'en voulait: des auteurs de province, c'est compliqué ! France 3 National n'en voulait pas, France 3 Marseille n'avait pas d'argent. Tout de même, quand on nous fermait la porte, on entrait par la fenêtre. Enfin, on a tourné Malaterra (diffusion 2003) qui a eu beaucoup de succès. Avec Philippe, il y a eu encore Liberata (diffusion 2005) et L'arche de Babel (diffusion 2007).
Fili : Quelle différence fais-tu entre écritures de livres et tout à coup l'écriture cinématographique ? D.L. : Je pourrais presque dire pareil… mais complètement différent. Pareil parce que c'est une dramaturgie avec un début, un développement, une fin, des éléments déclencheurs, des rebondissements. C'est ce que j'utilise quand j'écris. Mais l'image permet certaines choses, le livre en permet d'autres.
Le grand moment : la Bosnie
D.L. : Par la suite, j'ai fait des reportages sur la guerre en Bosnie pour RFI. J'ai suivi l'armée de l'Otan et ses déminages sur les lignes de front. De là vient Le quatrième cerveau. J'y reviens. Je tire mon écriture d'une action concrète, de rencontres, de mon vécu. J'avais participé à quelques reportages en Europe de l'Est. La première fois, pas question d'aller en Bosnie avec un véhicule. J'y suis allée en avion cargo, puis j'ai loué une voiture en Croatie, en Bosnie, il n'y avait plus rien. Ensuite, il y a eu mon camion "Goran". Il était costaud, beau et grand, il me rassurait, "Goran". Je l'ai acheté après mon premier voyage en Bosnie, pour être libre. J'avais besoin d'un endroit pour dormir (il n'y avait plus rien, pas d'hôtel) et assez costaud pour détaler vite. J'ai continué à voyager avec lui en Europe de l'Est pendant dix ans. Pour son premier voyage, nous sommes allés à Gucca, le plus grand festival de fanfares tziganes des Balkans du sud (ex-Yougoslavie, Macédoine, Roumanie). C'est un festival où le village passe de cinq cent habitants à plusieurs milliers. C'est tout près de là qu'habite Emir Kusturica et qu'il a tourné ses films. Je suis allée chez lui. "Goran" a été baptisé là bas à la slibovic, un alcool local de prunes fait maison).
Son nom, c'est le prénom de Goran Bregovic, le compositeur qui a écrit les musiques des premiers films de Kusturica. Mon camion est l'un des amours de ma vie. On peut être amoureuse de son camion ! Je l'ai vendu il y a un an à un copain. Je n'avais plus les moyens de voyager et plus d'endroit où le garer. Mais pourquoi tout d'un coup aller écouter de la musique tzigane, me direz-vous. C'est une musique que je connaissais depuis longtemps, ces orchestres pour mariage et enterrements. Et du fait que je joue dans une fanfare et suis passionnée par Kusturica, par cette culture, le passé des Balkans, mon expérience de guerre, il était normal que je me retrouve là-bas. Quand il y a eu cette guerre, dans un pays proche, j'ai été très troublée. C'est un pays où j'étais beaucoup allée quand j'étais gamine avec mes parents. Dans une famille communiste, on allait en vacances dans un pays communiste et la Yougoslavie était le plus proche. Plus tard, j'y étais retournée avec mon mari, on avait des amis là-bas. La guerre dans un pays lointain m'émeut, mais ne m'impacte pas comme dans un pays où j'avais marché dans les rues... Tout le monde me disait :"Tu es folle". J'y suis allée en 1995, la dernière année de la guerre. Je suis partie l'été, sans rien dire à personne. Mon mari avait amené les enfants au château de Grignan, où il travaillait pour deux mois. J'avais des amis qui travaillaient pour le H.C.R. et l'O.N.U. J'ai pris un avion pour Zurich, puis un avion cargo pour Sarajevo. Je répondais, je passais à la radio. Ça s'appelle observateur. J'ai participé à des reportages.
Le "quatrième" cerveau Fili : Pourquoi le "quatrième" cerveau ? D.L. : D'après une légende de là-bas, on a quatre cerveaux : le premier sert à vivre au quotidien, le second à aimer, le troisième à se souvenir et dans le quatrième on enferme tout ce que l'on doit oublier. J'ai retiré des Balkans un sentiment de grande liberté. Depardon le disait. Je faisais ce que je voulais, il n'y avait plus de police, plus de feu rouge, de magasins, une absence de limites. Je me suis retrouvée totalement libre, de tout. Je pouvais rouler à 200 à l'heure, je pouvais m'arrêter, tout le monde s'en foutait. Une liberté, mais aussi avec des contraintes terribles. La peur des mines anti-personnelles et anti-char. Il fallait faire pipi sur les routes. L'accueil était extraordinaire, j'ai pris 500 photos de maisons en ruine. J'avais un peu honte. Les gens me disaient "Prenez des photos, montrez ce qui se passe..." Il faut voir la vérité par soi-même mais pas à travers le prisme de son pays, le monde est plus compliqué… Il y avait des serbes qui avaient subi des choses abominables. Nous sommes devenus amis. Un d'entre eux me disait : "Arrête avec ton cerveau de petite Française planquée...". J'ai appris à ne pas avoir peur. Le meilleur moyen de ne pas avoir peur est de faire face. Il n'y avait plus aucun repère. Tu es dans l'authenticité de ce que tu ressens. Tout manquait. Une fois, je me suis aperçue que je n'avais pas mangé depuis la veille. Pas de magasins, rien. Qu'est-ce que je pourrais manger ? On me vend un vieux paquet de biscuits. Après, tu relativises les petits maux, le ménage qui n'est pas fait, l'argent qui manque. Si tu ne l'as pas vécu, tu ne peux pas comprendre... Une anecdote : j'avais besoin d'argent, on pouvait en avoir dans les grands hôtels. Je vois un distributeur. Je mets ma carte dedans, j'entends « ploc », je fais le tour : il n'y avait que le mur et ma carte était juste ce qu'elle était, un bout de plastique.
En quête de ce que l'on a perdu D.L. : À la guerre, tout est possible. Mon père était résistant. Il me disait : "On pouvait faire le meilleur comme le pire". Ce n'était pas ma guerre, j'étais juste observatrice. À travers tout cela, je retrouvais le récit de mes grands parents, les Russes, la destruction de Saint-Pétersbourg, toutes ces descriptions qui sont presque une conscience génétique, la compréhension de la ruine. Est-ce qu'un enfant jouait là ? Ma mère me racontait que lorsque j'étais petite, je pleurais quand je voyais des maisons en ruine. Et à l'époque, il y en avait beaucoup en Provence.
Apprendre que je suis vieille ! D.L. : En 2011, j'avais 51 ans, j'ai appris que j'étais vieille ! C'est drôle à dire, France Télévision m'avait payée une formation très chère au CEEA (Conservatoire Européen d'Ecriture Scénaristique). À l'issue, on devait avoir un projet à présenter, en l'occurrence pour moi à France Télévision... Canal aussi était là ! Ça s'est bien passé, mais personne ne m'a plus contactée. Pendant le stage, j'ai vu que les autres avait 30, 35 ans. Puis on m'a dit : "Mais Dominique, t'as vu l'âge que tu as ? Pour eux, tu es has been". Ça m'a énormément vexée. J'ai répondu à d'autres appels d'offre, mais on m'a fait comprendre qu'avec mes histoires de guerre, d'espionnage, de gens traumatisés, j'avais des idées de vieille. Je ne sais pas ce que c'est, des idées de vieilles ! Et puis beaucoup de vieilles personnes regardent la télé. Des idées de vieilles pourraient leur faire plaisir, après tout ! Mais donc, j'étais has been... Fili : Pourtant c'était d'actualité ! DL : Dans mon projet, je ne parlais pas de la Bosnie (c'était déjà ancien), mais d'Afghanistan, d'un soldat qui revient. Canal a acheté aux Etats Unis une série qui raconte à peu près le même genre d'histoire Homeland, un mec qui revenait de la guerre complètement cinglé, avec un double "je"... À cette époque, je n'ai plus de travail du tout ou peut-être juste comme stagiaire, pour apporter les cafés, mais je n'en avais pas envie. Vieille ? Je n'arrivais pas à me mettre ça dans la tête. Mais quand c'est la société qui renvoie cette image, on a intérêt à se remettre en question. J'ai réfléchi pendant deux ans et clôturé ce temps de réflexion par une marche de 300 km seule sur le chemin de Compostelle, de St-Jean-Pied-de-Port à Burgos. Fili : Parle-nous de Compostelle… DL : C'est une chose que je voulais faire depuis longtemps mais on se dit toujours "pas le temps". Donc je suis partie fin mai début juin 2015, en Espagne, pour parler une autre langue, être ailleurs... Traverser toute seule les Pyrénées à pied, de nombreuses rencontres, des moments pour le soir, boire des coups, chanter des chansons chacun de notre pays, partager du temps et être bienveillant. Je ne connaissais pas ce mot dans ce sens-là. J'ai appris que chacun peut compter sur l'autre, à partir du moment où chacun est attentif à l'autre : ça m'a fait beaucoup de bien. Et relativiser : "la télévision ne veut plus de moi, eh bien tant pis ! Il y a d'autres choses à faire dans la vie". La bienveillance envers son voisin, c'est bien, mais envers tout le monde, c'est formidable. Je me suis demandée ce que je pouvais faire à ma petite échelle. J'ai rencontré des gens formidables de l'association One piece of rubbish ("Un déchet par jour"). Jusqu'à présent, quand je voyais quelqu'un jeter des poubelles de sa voiture, je lui courais après et lui re-balançais son déchet dans la voiture. Mais ce n'est pas ce qu'il faut faire ! Le truc, c'est de ramasser. On a l'air bête, on a l'air humble, de ramasser ce que d'autres ont jeté, mais ça peut les aider à réfléchir. Si chaque personne ramasse un bout de papier dans la journée, ça en fera beaucoup moins. Donc, depuis, je fais ça... et aussi les campagnes de ramassage (La Corniche à Marseille, Notre-Dame de la Garde). On a créé le jardin associatif de la colline, avec des plantes que l'on met dans la rue, ces choses-là ont fait des petits. Des gens ont végétalisé les rues. De plus en plus de personnes travaillent ensemble sur ces petits actes citoyens. Je fais, du verbe "faire". Nous sommes les "faiseux". Dans tous les domaines il y a des gens qui ont envie que des choses se passent. Ils votent blanc ou ne votent plus car ils sont déçus de la politique. Ils veulent juste arriver - ce n'est ni de droite, ni de gauche, ni d'une religion quelle qu'elle soit - à trouver un chemin pour partager le territoire et la vie, sans se marcher dessus les uns les autres et en se filant un coup de main.
- 2 - Vie de famille, création… le grand écart ?
Tu illustres à travers ta vie une certaine idée d'indépendance et de la liberté chez la femme. Est-ce une volonté ou bien un simple hasard ? Quelle place octroies-tu à la famille dans ta vie ? DL : Je viens d'une famille où on m'a appris que ce qu'il y a de plus important, c'est de faire ce qu'on aime, dont on a envie et d'être ce qu'on est, sans nuire aux autres. Que la vie est un passage sur terre et que si on peut en profiter pour faire, si on est bien soi-même, les autres sont bien. J'ai toujours mis ça en pratique. Dans la famille de mon mari, il fallait travailler en usine. Heureusement, nous avons voulu souvent les mêmes choses, car il faut se croiser de temps en temps, mais nous avons une très forte indépendance. Chanteur d'opéra, il a longtemps été en tournée, absent parfois six mois par an. Les enfants ne voyaient pas leur père, ni moi mon mari, mais c'était dans la bonne humeur et dans la joie, sans pathos. On avait une carte de France avec une épingle représentant Daniel (mon mari) et une autre me représentant moi ; ainsi les enfants savaient où était maman, où était papa. Mes enfants ont toujours été intégrés à nos activités dans la limite du possible, bien sûr. Quand ils étaient petits, j'étais à la maison, avec eux : à 20h, repas, devoirs, au lit ! Ils étaient aussi musiciens. Alors on partait en vacances avec les instruments, les partitions, ils faisaient d'abord leur solfège, leur violon, et après on allait se balader au bord de la mer, à la montagne... Et aussi, durant sept ans, comme mon mari travaillait deux mois pendant les vacances sur les fêtes nocturnes à Grignan, nos enfants passaient ces deux mois au Château de Grignan. Vivre la vie de château, ça marque ! Mon fils est aujourd'hui compositeur de musique à l'image et violoniste, ma fille est comédienne chanteuse et a été nommée aux Molières. Du bon niveau : on a été très stricts sur les études. Mais c'est vrai que parfois, on préférait passer quinze jours en Grèce que suivre quinze jours d'école. C'est peut-être un peu marginal, mais autour de nous, tous nos amis vivaient de la même manière. Ça n'a jamais posé de problème de famille... sauf quand j'ai fait le coup de la Bosnie à mon mari. Il croyait que j'étais à la maison, à Marseille ; il m'appelait d'un supermarché où il faisait les courses avec les enfants, il m'a demandé une recette. Je lui dis : "Écoute, là, je peux pas te répondre. Je suis sur la route en Bosnie. Y a des mines partout..." "Mais tu es cinglée !", a-t-il dit et après, il s'est inquiété. C'était un petit peu extrême. Pourtant, je ne prenais pas de risque, je voulais que mes enfants aient une mère le plus longtemps possible.
De l'intérêt de naître dans une famille d'artistes : créer et être soi-même ! D'où t'est venu ce désir de création ? DL : Il vient de mes parents, il fallait créer ! Ils me poussaient à créer dans mes devoirs. Difficile dans un devoir de maths. Ils s'engueulaient avec tout le monde à cause de ça ! Ils n'envisageaient pas la vie sans création. Pour moi, créer, c'était la normalité ! On allait balader, on ramassait des cailloux, on les empilait. Du Land Art sans le savoir ! On ramenait des bouts de bois et on les collait. Ma mère posait, mon frère et moi, on dessinait... et mon père peignait ! Maman - Guitta Sergueieff est son nom -, était un peu créateur comme le Facteur Cheval ! Elle créait dans l'ombre de mon père, le génie, c'était lui ! Mais ma mère, avec les fonds de palette et les fonds de tube, peignait. Elle a été une enfant abandonnée, habitée par le nitchevo russe, une souffrance, de la mélancolie à la joie la plus extrême ! Elle écrivait aussi beaucoup : elle était poète ! Il y avait en elle ce rapport à l'écriture toujours présent ! Chez moi, ça a mis du temps car j'avais toujours ce complexe d'infériorité par rapport à mes parents que je trouvais formidables. Jusqu'au jour où ça m'a passé. Mon père, François Lombardi, était artiste-peintre et sculpteur, plasticien, dirait-on aujourd'hui ! Un peintre de l'époque du Peano, le bar du Vieux-Port où se réunissaient tous les artistes marseillais, Ambrogiani, etc. Pendant la guerre, il était dans le maquis. Après, il en a eu tellement marre qu'il est parti à Paris, devenu Zazou au Tabou. Il a fréquenté Boris Vian et d'autres. Quand il est revenu à Marseille, il a retrouvé l'ambiance déjantée du Peano. Ma mère, elle, devait être danseuse quand elle a rencontré mon père. Elle figure sous le nom de Guita Sergueïev, danseuse russe, peintre naïf, dans le Dictionnaire des femmes marseillaises. C'étaient de bons vivants qui rigolaient de tout. Mon père n'hésitait pas à montrer son cul à la bourgeoisie venue s'encanailler... ma mère dansait à moitié nue sur les tables ; une vie de bohème. Pour moi, c'était merveilleux ! Après, avec mes parents, on passait de l'opulence à la précarité ! Ne pas avoir d'argent, mes parents s'en foutaient !!! On prenait alors trois petits-déjeuners par jour : mon frère et moi, on trouvait ça très marrant !" On habitait au Roucas Blanc dans la villa superbe d'un mécène qui l'avait filée à mes parents et où l'on a vécu jusqu'à sa mort. On vivait de façon grandiose sans un rond ! C'était assez drôle !
Règle-t-on "des questions" à travers la création ? DL : Je n'ai pas de revanche à prendre ! Je mets juste des petits cailloux les uns sur les autres, j'ai la nécessité de les mettre, de recréer quelque part l'univers perdu de mes familles qui sont des familles de migrants, surtout les Russes qui ont tout perdu et qui en plus ont été massacrés ! C'est une recherche perpétuelle d'un passé que je réinvente... et d'un présent... Quand on joue (je pense aux fanfares auxquelles je participe), c'est la fête : on s'amuse, on fait plaisir, on rigole, je me déguise, je mets des jupes courtes comme si j'avais 20 ans et on fait n'importe quoi. Si le public est content, je suis contente ! Tout simple ! Ce que je leur apporte : de la joie ! Mais je ne suis pas toute seule, on est une vingtaine dans les fanfares. C'est un moment où on se retrouve en pleine rue à danser le tango, l'oubli de la vie de tous les jours…
"Oh non ! Tu ne vas pas recommencer !" DL : Ce matin à la radio, j'ai entendu qu'ils envoyaient des observateurs en Syrie et donc j'ai dit à mon mari : "Dommage je ne pourrais plus courir assez vite à présent, mais j'aimerais bien y aller". Il m'a répondu : "Oh non ! Tu ne vas pas recommencer !" Mais il faut bien gagner sa vie et quand j'ai une idée qui me passe par la tête, je la fais. Donc je suis revenue à d'anciennes amours et me suis remise à la brocante. Mon père, pour gagner sa vie, avait été brocanteur. Il achetait, retapait, revendait. À mon tour, je récupère, j'achète aux Puces, je transforme. Ce qui me permet un travail de création mais ancré dans le présent puisque je vends sur internet. En fait, je suis toujours en train de me reconstituer un truc du passé. Pourtant, je suis quelqu'un du présent, mais avec un passé que je n'ai pas connu qui me colle à la peau (la première moitié du XXème siècle). Fili : En fait, tu as "emmagasiné" tout ce qui ne t'a pas été dit… DL : Non seulement je l'ai emmagasiné, mais j'ai inventé des morceaux, j'ai brodé. Mon nouveau projet est d'aller à St. Peterbourg. Je suis en train de mettre des jalons pour retrouver des traces familiales à partir des papiers de mon grand-père, m'intéresser à l'histoire de sa ville. Je voudrais aller aux Archives suivre le parcours que l'on connait, c'est-à-dire en 1914, retrouver des traces de cette famille noble proche du tsar. Mon grand-père était cadet du tsar. Il a fui par l'Angleterre, puis est allé à Buenos Aires, a eu une vie très tumultueuse avant d'arriver à trente ans à Marseille mais on aurait dit qu'il vécu trois vies ! Là-bas, il faut que je trouve l'adresse de la datcha familiale près de Kiev et des documents pour savoir s'ils ont été exécutés à Kiev ou déportés en Sibérie, donc peut-être aller en Sibérie. Un périple où j'ai besoin d'aide, de temps, d'argent. Un truc qui me tient à cœur. Jusqu'à Gorbatchev, ma famille était interdite en Russie car mon grand père était noble. Le paradoxe, c'est que mon père, lui, était communiste. Pendant la guerre, il était dans un maquis. De là, mes parents sont partis dans ce qu'on appelle le communisme des artistes. À Marseille, on appelait ce mouvement "les artistes prolétariens". Ils ont fait de grandes fresques pour la CGT, les dockers en grève, la guerre du Vietnam… J'ai baigné là-dedans, ne suis allée que dans des colonies de vacances communistes. Jusqu'aux années 1970 où mon père a commencé une peinture différente. Il a fallu qu'il fasse son autocritique au sein de la cellule du parti. Il leur a dit : "je vous emmerde !" et il a foutu le camp. À partir de là, il est devenu anarchiste et le communisme s'est arrêté dans ma famille.
Un entretien réalisé par Arlette Anave, Jeannine Anziani, Annie Skrhak avec l'aide pour la transcription de Jean-Jacques Maredi.
|
|
|