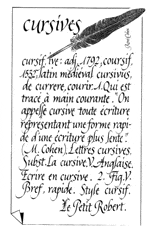Filigranes est allé rencontrer le sculpteur, peintre, calligraphe et poète Thierry Hamy dans son atelier à La Garde (Var), ouvert au public. Nous sommes aussi allés voir la statue monumentale qu’il a réalisée à Bormes-les-Mimosas et les œuvres des enfants de Signes réalisées sous sa direction. Après une petite enfance au Sénégal, Thierry a presque toujours vécu dans l’agglomération toulonnaise. Mais il a effectué un séjour très marquant à Calcutta chez Mère Teresa à l’âge de vingt ans, avec des haltes au retour en Israël, en Jordanie et en Égypte, où il a vécu de ses talents de portraitiste et offert ses services à différentes communautés. Au fil de ses expositions et des cours à ses élèves, ainsi que des spectacles associant calligraphie et chanson auxquels il a participé, il a eu l’occasion de partager cette passion de la beauté qui le fait vivre et c’est de cela qu’il nous a longuement entretenus.
Comment es-tu devenu sculpteur ?
J’ai commencé à faire de la musique dans un groupe de rock à 11 ans. La découverte du yoga et de la méditation à 14 ans m’a conduit à abandonner la musique pour aller vers quelque chose de plus incarné. Le musicien plaque un accord sur un clavier et déjà il voit des couleurs, un monde s’ouvre à lui, une fenêtre vers l’invisible. Allez faire la même chose avec un bout de bois, un caillou ou de la boue ! Voilà ce que j’ai appris aux Beaux-Arts. J’y suis entré à 15 ans pour apprendre le portrait et vivre de mon art sur les routes du monde. Je ne voulais pas tendre le chapeau comme les musiciens, je préférais avoir une rémunération plus digne que faire la manche. J’ai eu cette chance, à la même époque, de rencontrer l’enseignement de Gandhi. Plusieurs de ses phrases ont été déterminantes dans mon choix professionnel. Il disait par exemple : « L’apprentissage de l’honnêteté, c’est le travail des mains. » ou « Si tu veux changer la société, commence par toi-même. » Et puis, le portrait me permettait d’entrer en résonance avec la personne que j’avais en face de moi, très vite, par le regard, par la fenêtre des yeux. Quand tu fais des portraits, tu peux te plonger dans les yeux de ton modèle, tu lui donnes le meilleur et lui il te donne le meilleur.
Et après tu es parti à Calcutta soigner les lépreux chez Mère Teresa ?
Ce que je suis allé chercher chez Mère Teresa, c’est la prière en action, c’est-à-dire l’intériorité manifestée par des actes. J’ai eu cette chance d’être près d’elle chaque matin pendant six mois, à Mother House. Mère Teresa avait vraiment un courage infini. Je voulais aussi rencontrer Mâ Ananda Moyî, une sainte très connue en Inde. Là où il y a des saints, c’est comme le miel avec les abeilles : on ne trouve pas que des curieux, mais aussi des assoiffés de force spirituelle attirés par ces personnes.
Qu’as-tu retenu de plus important auprès de Mère Teresa ? Son enseignement se résumait à cette phrase, pourrait-on dire : « Ne faites pas de grandes choses petitement, faites de petites choses grandement. » C’était tout-à-fait conforme à ce que j’avais appris durant ma formation de sculpteur : l’art monumental est un art synthétique. Vous devez éliminer le superflu et aller vers l’essence. Ce qui m’attirait vers elle et vers les malades que je soignais, c’est qu’ils avaient capté l’essentiel de la vie et moi j’avais besoin de rencontrer des gens qui me donnent de l’espoir en l’humain.
En quoi consiste pour toi le travail de l’artiste ? Depuis l’adolescence, ma pratique sincère et intense du yoga, de la méditation, de la charité en actes m’avait poussé à prier avec mes bras et de toutes mes forces. C’est pourquoi jusqu’à l’âge d’homme réaliser une œuvre personnelle m’était chose difficile, comme si je ne me l’autorisais pas, comme si c’était un temps un peu volé à autrui, comme si, durant ce temps, je n’étais plus au service de l’autre. Avant d’entrer aux Beaux-Arts, cette créativité, cette inventivité artistique, je la vivais déjà mais au sein de mon groupe de musique. C’est lorsque j’ai commencé à œuvrer, sans support humain extérieur, seul dans l’atelier de sculpture mais fort de tout ce que m’avaient transmis mes deux maitres de sculpture, modelage et dessin, que j’ai expérimenté la profondeur et la hauteur que l’on pouvait atteindre par la concentration à travers la discipline artistique très manuelle, très technique et très solitaire qu’est la sculpture. Entrer dans un autre temps hors de l’immédiat, œuvrer sans attendre de reconnaissance d’autrui ni même de jouissance du fruit de ses efforts, c’est pour moi l’un des véritables prérequis de la créativité. Ce n’est ni par sacrifice ni par abnégation, c’est tout simplement parce qu’en cette disponibilité d’esprit nous sommes et devenons vraiment ce que nous sommes, ce pour quoi nous sommes faits, ce pour quoi nous sommes là. Quand la force venant de la terre, de la matière, est mue par un mental désentravé, par une raison qui n’est pas personnelle, par une conscience bienveillante qui ne cherche pas à nuire, le neuf apparait. C’est une vigilance de tous les instants pour ne pas tuer ce qui est en train de naitre, savoir s’arrêter, renoncer à l’achevé pour toucher à l’accompli. C’est le discernement qui vient avec le temps.
Comment définirais-tu le processus de création ?
La conception n’est pas le seul moment de la création qui est un processus s’inscrivant dans le long terme. Chaque œuvre en est un jalon. L’artiste doit assumer les 3 temps de l’œuvre qui pour moi sont fondamentaux : la paternité, la maternité et la sage-femme. La paternité, c’est juste le moment de la semence, qu’on peut figurer comme un arc, comme un pont sur l’abîme d’où l’on voit tout au fond de soi l’idée, l’image ou la forme que nul n’a jamais vue ni conçue, la parole que nul autre que nous ne peut prononcer. La maternité dure neuf mois, la mère donne les briques de son corps : vous devez maîtriser les techniques, les outils et les matériaux. La sage-femme, c’est arriver à prendre du recul au moment de la patine en apportant tout ce qui s’est passé avant, pendant et après la réalisation, c’est la méditation poétique qui nait à ce moment-là. On voit l’œuvre pour la première fois toute entière. Je vois l’enfant en train de naître, s’il est viable ou pas, je le refaçonne un petit peu. J’entends son premier cri, il est déjà autonome. Pour moi c’est très important de résoudre par moi-même tous les problèmes techniques qui se posent quand on veut réaliser une sculpture. J’ai appris à couler le bronze, à tailler la pierre, parce que je ne concevais pas de laisser ce travail à d’autres. Il faut assumer toutes ces étapes du travail manuel en sculpture, sinon on est un imposteur. Et puis, ce temps-là, où on bute sur les questions techniques – comment faire une statue de quatre mètres dans un petit atelier, par exemple – c’est un temps de mûrissement du projet et de grandes joies et de découvertes qui sont une vraie richesse.
Tu dis que l’artiste est avant tout un serviteur de la beauté : qu’entends-tu par cela ?
Il sait dire le plus, avec le moins, et le meilleur souvent avec le pire. C’est un réconciliateur qui touche à l’unité en dépassant les contradictions. Pour moi, la haine n’est pas l’inverse ou l’opposé de l’amour, c’est tout simplement son manque. La laideur, ce n’est pas l’inverse de la beauté, mais tout simplement son absence. La beauté véritable est comme la joie vraie, c’est celle qui reste après tous nos outrages, toutes nos blessures, toutes nos tristesses, toutes nos caresses aussi. La vraie joie n’est pas un brasier qui dévore, c’est libre, léger comme un oiseau. Le monument qui m’a été commandé par la ville de Bormes-les-Mimosas, je l’ai intitulé L’Oiseau de l’âme. J’ai voulu y traduire la beauté nue de l’âme humaine : un corps s’élance vers le ciel, au bout de son doigt il y a l’oiseau de l’âme qui n’est pas un oiseau terrestre car il est très stylisé, très lisse, comme de l’or. Au point de contact entre l’index et l’oiseau, le spectateur voit qu’il se passe quelque chose : au sommet de son être, l’esprit se matérialise et le corps tendu vers l’esprit se spiritualise. Il devient conscient de son âme, il est une âme vivante, comme disaient les psaumes. Ceux qui m’ont aidé dans cette voie, ce sont les vrais artistes, comme Vincent Van Gogh par exemple. J’ai tant de tendresse et de reconnaissance pour ses efforts, pour son œuvre ! Quand il peint deux vieux godillots, en quelques taches de goudron sur une toile souillée, j’y trouve plus de grandeur, de justesse et d’humanité que dans la grande théorie de Kant sur le sublime et sur le beau. Il met toute son âme quand il peint ! Et pas seulement son âme, c’est celle du monde qui vibre dans les nuages. Son cyprès est une leçon de vie à toutes les académies : c’est Van Gogh qui a éduqué mon regard à sentir cette prière de sève qui s’élance vers la nuit. Et les étoiles scintillent et la lune est là en même temps en plein jour. C’est une totalité, ce tableau sur les cyprès : l’homme y est à sa place, fort et humble à la fois, juste en dessous. Van Gogh n’est pas seulement un maître de peinture, c’est un vrai poète. J’essaie de suivre cet exemple : je ne suis pas en quête du sublime, les choses simples me suffisent. Je ne suis pas amoureux des choses que je fais, je ne m’y attache pas ; je sais ce qu’elles valent, ce qu’elles m’ont coûté d’efforts, d’ardeur, de sueur. Je ne cherche ni le plus ni le peu mais seulement le juste, le vrai, le beau, je reste platonicien dans ma démarche. Si un jour je n’ai plus mes yeux, mes bras, j’aurai encore mes oreilles et ma voix. Et si je n’ai plus cela, il me restera ce qui est l’essence même, et qui demeure éternel. Un sculpteur a besoin d’espace, d’un atelier, de matériaux, un peintre aussi ; un musicien, de son instrument, un chanteur, juste de sa voix. Mais quand il n’y a plus rien, il reste la parole, le verbe qui resplendit, qui fait qu’un rien peut devenir le tout. Même si la beauté véritable nous laisse sans voix : nos mots et nos pensées sont les arrière-petits-fils de la parole suprême, qui est silence.
Mais pourtant la sculpture c’est très sensuel, incarné ?
Je vais vous raconter ma première expérience de dessin d’après nature. À 15 ans, nous étions 33 dans la classe, on ne nous avait pas prévenus et voilà qu’entre une jeune femme d’une trentaine d’années, une splendeur, qui commence à se déshabiller… nous les gars on était rouges comme des pivoines. En un quart d’heure, notre maître nous a aidés à la voir non comme un objet de désir ou un fruit à dévorer, mais comme un fruit à contempler, un ensemble de lignes de forces. Avant de sculpter la pierre et faire la mise au point avec la macchinetta à l’échelle 1, il faut savoir faire les armatures qui sont en fait l’âme de la sculpture, les lignes de force. Et il faut qu’elles ne dépassent pas de l’extérieur, ce qui exige de savoir exactement axer votre trait au milieu de la forme. Avec 3 lignes de force, pas plus, sinon on est trop bavard : regardez pour Le Discobole, 2 lignes de force, les deux incurvées, pas davantage. Le bloc était peut-être carré au départ, mais quand on voit Le Discobole, on voit une sphère, un mouvement qui ne finit pas dans une sphéricité. Il est très important d’acquérir cela ! En un quart d’heure, M. Nicolas nous a fait aller du regard de la chair à celui de la contemplation. C’est extraordinaire, le regard qui ne salit pas le corps de l’autre, mais qui, par cette beauté qui se manifeste dans sa totalité, anoblit le regard de celui qui regarde.
Avec quels matériaux travailles-tu ?
TH : D’abord la terre, le modelage, l’argile, qui permet une grande autonomie à tous les niveaux, technique et financier, parce qu’on la recycle ; depuis 45 ans, je la recycle. Ensuite le marbre… Rendez-vous compte du privilège d’un sculpteur : c’est une roche métamorphique, il a fallu une pression énorme, une chaleur inouïe pour silicifier cette pierre. Et quand elle sort du cœur de la matière, elle est encore tendre, c’est l’acide de l’air qui la durcit. Quand vous chassez le premier éclat, c’est étincelant comme neige. On pourrait dire que je suis un matérialiste divin, parce que vraiment pour moi la matière est sacrée, quand on compagnonne avec elle, pas quand on la percute, pas quand on travaille contre elle. On n’apprivoisera jamais la matière, elle est le maître qui commande. Par contre, on peut en faire un partenaire, un compagnon, un ami. C’est une joie immense que sculpter le marbre, parce que c’est une pierre qui rappelle l’épiderme de l’homme, de l’humain, de la femme. Après avoir sculpté, vous dégrossissez à la gradine, puis au scalpel, ensuite parfois au rifloir et vous poncez. Vous arrivez à faire palpiter un flanc avec la même sensation que pour une chair humaine.
Aujourd’hui tu travailles plutôt le plâtre et la résine ?
J’ai cette chance de maîtriser les outils du marbre et du bronze mais j’ai arrêté, pour des raisons de conscience : je n’en ferai plus, j’ai trop vu la gabegie par rapport à l’énergie et aux matériaux dépensés. Mais ne pensez pas que le plâtre n’est pas un matériau noble… J’ai de la famille dans le Vaucluse qui travaillait dans les plâtrières : le gypse, ce sont des sédiments composés de coquillages et de corpuscules monocellulaires qui, depuis la création du monde, se sont déposés au fond des océans, comme dans le Bassin Parisien ou dans le Vaucluse, pour former ces couches énormes dont nous extrayons le plâtre. C’est très émouvant, ces particules de gypse qui forment de petites rivières quand il pleut, se jettent dans la Sorgue pour aller dans la Méditerranée, retournent dans la mer donc… et la boucle est bouclée.
Pourquoi ne cuis-tu pas la terre ?
La cuisson de l’argile, c’est de l’électricité nucléaire. Tant qu’on ne sait pas quoi faire des poisons qu’on produit, il faut arrêter de les produire ! Quand on est lucide et conscient des choses, on sait qu’il y a du sang derrière le bouton sur lequel on appuie. Donc je recycle la terre, je la refonds. Mon compromis, pour le moment, pour le projet monumental que j’ai réalisé pour la ville de Bormes, c’est la résine, donc la pétrochimie. Mais pour moi il n’y a pas photo entre le pétrole et le nucléaire. J’emploie les pigments et les techniques qui ont été éprouvés dans le temps. Le recours à l’artifice est pour moi une trahison du vrai, et donc de la beauté, parce qu’il n’y a pas de beauté sans vérité. J’ai soixante ans, et j’ai vu les dégâts de la pétrochimie, de l’obsolescence programmée, de la surproduction, de la surconsommation, du surarmement, de la déforestation, de la spéculation boursière, des déchets nucléaires, de l’exploitation animale et humaine… tout cela n’est pas tenable, et rien ne nous oblige à entretenir ce courant mortifère. Je vois tant de gens que j’ai formés faire aujourd’hui du bronze pour faire de l’argent ! L’art me verticalise, me permet d’être un homme digne, de vivre du travail de mes mains, en étant le moins prédateur possible et en respectant les autres êtres humains. Si je m’efforce d’être un artiste en transition énergétique, ce n’est pas ni pour me donner bonne conscience ni pour être la mauvaise conscience d’autrui. C’est tout simplement pour être en accord avec la terre, les humains et les animaux pour témoigner par mes choix, mes actes et mes œuvres que cette excroissance prédatrice et mortifère d’une certaine modernité n’est pas une fatalité. Pendant des milliers d’années, durant le néolithique, les hommes ont vécu en accord avec la nature. Le shibui des Japonais, la vie sobre, idée reprise par Pierre Rabhi sous le terme « sobriété heureuse », dit qu’on peut très bien se passer de toute cette technologie.
Tu es sculpteur mais tu es aussi calligraphe…
Lors de mon voyage en Inde, j’étais déjà très intéressé par toutes les écritures et les alphabets. Partout où je suis passé, j’ai essayé d’apprendre les rudiments, pour l’arabe, le sanskrit, le tibétain, l’hébreu, le persan. C’étaient les enfants qui m’apprenaient : dans la boue ou le sable, avec l’eau sur le carrelage, dans le curry sur le plateau du petit déjeuner. À mon retour, je me suis renseigné sur la calligraphie latine, à une époque où personne ou presque ne s’y intéressait. J’avais cette envie de conjuguer les écritures du monde pour lutter contre les préjugés et dire : « C’est la même grande sagesse partout qui est là avec des langages différents. » Mais je me suis vraiment mis à la calligraphie en 1998 (à quarante ans), quand je me suis cassé le poignet et que j’ai été privé de ma main gauche pendant un an. Cela m’a permis de vivre et j’ai animé très vite des ateliers, formé des élèves. La calligraphie est une école de vérité : normalement c’est un seul trait du pinceau lié au souffle. La feuille blanche c’est le lieu de tous les possibles, et là je laisse venir, comme pour le poème, sans préméditation. Je suis toute perception et j’attends : il y a quelque chose de très précis qui attend pour émerger comme un petit poussin derrière la coquille. En Occident où c’est le résultat qui compte plus que le chemin, beaucoup de calligraphes trichent, retouchent à la machine et s’éloignent de cette démarche. En calligraphie comme dans la vie, tout est question de souffle et de rythme. Le scripteur imprime son souffle au trait et le corps même d’une lettre bien tracée peut rendre ce souffle perceptible. Le « souffle de la lettre » peut inspirer la vie à l’être qui l’écrit comme à celui qui la lit. La sculpture vient souvent d’un geste calligraphié qui n’est pas prémédité. En trois secondes tu as l’idée de la sculpture, mais pour la réaliser il faut des semaines !
Et la poésie, quel rôle joue-t-elle dans ta vie ?
Ce qui est merveilleux dans la vie humaine, les antiques l’avaient bien compris, est que nous sommes une triple unité, corps âme esprit. Mais toute l’expérience passe par le corps. La mémoire est dans le corps avant tout, c’est flagrant pour les odeurs. Et pour moi la calligraphie, la sculpture, la poésie sont une exploration complète, globale, de cette triple unité humaine. La calligraphie et la poésie tout autant que la sculpture chez moi passent par le corps. Et ma poésie est toujours la mise en mots d’une expérience vécue. Souvent, chez moi, avant d’être parole, image ou idée, le poème est un rythme. Les mots viennent, scandés par la cadence de mon cœur et celle de mes pas. Et c’est en marchant que se fait le poème, c’est en marchant que je le compose et le mémorise. La pensée est dynamisée par la marche, la parole tamisée par le souffle et le vent comme sur les grandes aires de battage où le grain restait au sol, tandis que la paille s’envolait. Et puis le poème, c’est aussi ce qui vient après la sculpture. Tout ce processus de réalisation dans la durée, je le poétise. Ainsi nul ne pourra me déposséder du sens profond de ce que j’ai voulu dire.
L’alphabet de l’âme Comme un divin babil, il se récite en silence… Toujours nouveau, fluide et rapide, il réchauffe et rénove les cœurs.
Comment passe-t-on de l’expérience vécue au poème ? Au départ il y a ce silence, cette sorte d’impuissance face à toutes les possibilités qu’on peut en faire jaillir, mais ce n’est pas le vide. C’est plutôt un trop plein. C’est comme un immense réservoir qui ne peut pas passer par le petit entonnoir de la pensée. Alors il faut du temps, il faut de la fidélité, de la mémoire et le petit entonnoir finira par laisser passer les mots les plus ressemblants à ce qu’on a su voir, goûter, toucher, entendre. Mais la poésie n’est pas que dans l’écrit ou la parole. La force expressive de l’émerveillement n’est pas le monopole des artistes, on la trouve en chacun, chacune. La poésie est partout : d’abord dans l’œil de celui qui regarde, dans l’attitude et les gestes du balayeur tout autant que dans les pas du danseur. Dans tous les actes simples ou complexes mais posés avec attention, acuité, ardeur. Il est là le secret, c’est l’attention.
Tu as écrit beaucoup de cahiers, tu as rédigé des livrets qui résument ton expérience de la création et de la poésie et que tu offres à ceux et celles qui te le demandent, mais pourquoi n’as-tu jamais souhaité éditer tes écrits ?
On dévoile l’intime quand on écrit, surtout en poésie, et je trouve indécent de monnayer ce qui vient du plus intime, surtout depuis qu’un voisin de chambrée, quand j’étais hospitalisé à Calcutta, m’a posé la question : « Que vas-tu faire en rentrant en France ? » Et un autre voisin indien de répondre : « Il va écrire un livre ! » J’avais vingt ans, cela m’a préservé de toute ambition éditoriale et m’a alerté sur ma fonction et mon rôle d’écrivain. Le cahier Le cahier, c’est en vérité le refuge le plus sûr, le témoin le plus fidèle de nos vies, le garant de nos mémoires, le gardien de nos rêves, le dernier seuil de nos espérances, le tremplin de nos émois, le propulseur de nos pensées et le nautonier qui nous fait traverser le temps, l’espace. C’est le magicien qui transforme l’encre noire en un fil de clarté parsemant sur les pages les ferments de notre conscience.
Mais la transmission t’importe beaucoup ?
Oui, absolument. C’est en transmettant mon savoir aux élèves que j’ai pu approfondir mon chemin. Et puis les élèves, ce sont mes premiers mécènes. Grâce aux leçons, je suis indépendant vis-à-vis des commandes, je peux vivre sans peser sur personne, et en premier lieu sur mon épouse ! Mais je suis soucieux aussi d’aider mes élèves à devenir de bons sculpteurs, sans leur imposer ma vision de l’art ou de quoi que ce soit. C’est vrai que le temps que je passe avec mes élèves, je ne le passe pas à créer, mais je n’ai pas de regrets. Outre l’indépendance, ça m’a donné une autre approche de la psychologie que celle que je pouvais avoir de façon trop furtive en faisant des portraits. Les élèves m’ont aussi aidé à rester immergé dans ma technique en permanence. J’aime beaucoup les ateliers que j’anime l’été pendant un mois à Signes tous les jours depuis plus de quinze ans. Certains enfants sont venus plusieurs années de suite, je les ai vus grandir, j’ai vu leur personnalité se développer. Ils ont été si nombreux, visiteurs et apprentis sculpteurs, depuis plus de trente ans, à pousser la porte de l’atelier, que je l’ai appelé « l’atelier d’Hamy Baba et des quarante modeleurs » ! Ah ! ces âmes… Ma porte était ouverte, et la terre glaise leur a donné le « Sésame, ouvre-toi » de la caverne de leur cœur pour amener au jour l’œuvre de leurs mains. Avec certains élèves que j’ai vus grandir, vieillir, il y a un vrai compagnonnage.
Cet entretien a été réalisé
***
Ni voyou, ni voyeur, mais voyant… L’adolescence est le meilleur temps pour transformer le voyou et le voyeur potentiel en voyant véritable.
*** Le berger est poète souvent nu
*** Ce soir, la pâleur du ciel tombe. ***
Pour jaunir la surface de cette page blanche
***
Quels drôles de sons !
***
Elle s’appelle « Hirondelle »
***
Malentendu
|
|
|