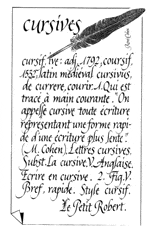|
|
|
|
|
De l'entretien véritable, commencé par une traversée du jardin car c’est là, dans le règne végétal et cosmique, que s’enracine l’écriture, à l'entretien publié quelques mois plus tard, bien des choses ont bougé, y compris à l'intérieur même. La matière de la parole recueillie y est sans cesse en mouvement dans son incomplétude.
Une écriture végétale Filigranes : En présentant ta pratique de l’écriture, tu nous as parlé d’Ikebana, l’art floral japonais. Geneviève Bertrand : Ces deux pratiques s’alimentent récipro-quement. Dans les deux cas, il s'agit d’un travail sur soi, sur la relation au monde. Une recherche intérieure d'harmonie, l'unité du geste et du coeur, la sortie de soi, l’écoute du végétal d’un côté, de la matière des mots de l’autre… La nature est très présente dans mes textes, comme un point de départ et d’arrivée. Fili : Les deux domaines s'offrent donc au regard l'un de l'autre… GB : Oui, je participe cet été à une expo d’Ikebana dans le parc oriental de Maulévrier près de Cholet. L'expo, (initiée par l’école de Marette Renaudin – www.ikebana-toulouse.com) porte le nom "d’écriture florale", et aura pour support le parc tout entier et le lac en son centre. Comme en poésie, il s’agit de transmettre et partager une joie, une magie, une émotion, un cheminement intérieur à la fois contemporain et enraciné dans une tradition, de porter la nature à un degré supérieur de beauté vivante et non formelle, de faire bouger le regard. Fili : Laquelle des deux pratiques serait première pour toi ? GB : Depuis quelques années, la place de l’écriture grandit au quotidien mais il y a vraiment interaction des deux. L’écriture est là pour méditer, me relier à une vérité qui nous habite et qui est plus grande que nous : l'absolu, le sacré, l'invisible, la dimension cachée du monde. Elle réunit tout en Un quand elle est pratiquée dans un certain esprit. Il y a des moments où je vais très mal, où il est difficile, d’arriver jusqu’à l’écriture, de se connecter au centre qui relie à l’univers, ce qu’en Ikebana on nomme «Hana no ko koro», le "coeur des fleurs". Lorsque j’y arrive, je ne suis plus malade ni fatiguée. S’opère alors une sortie du soi égotiste vers un ailleurs. La fonction de l’écriture - je parle de la poésie - se déploie donc sur différents niveaux, du thérapeutique au cathartique et à la prière. C’est aussi une forme d’engagement dans le monde, une façon "d’être au monde". C'est un surgissement. L’écriture peut alors devenir transmission, mouvement, témoignage, acte de résistance ou de critique, chant sacré.
Écriture et pensée GB : J'ai fait des études de philo, ce qui m'a formatée, voire engluée dans le discours conceptuel. J'ai mis des années à m'en séparer. Avec le zen, j'ai mis la rationalité à distance au profit d’une démarche plus intuitive - jusqu’à renverser la formule de Descartes et expérimenter le "je suis donc je pense". La transmission "I shin den shin" est hors langage, directement d’âme à âme et, dans ce cas, la connaissance et le discours discursif peuvent être un obstacle. Même si la pensée est une dimension fondamentale de l’humain, il existe chez de grands philosophes (Kant, Hegel) une façon excessive de l'exercer, une façon faisant système. Mon choix est de cultiver d'autres dimensions : l'intuitif, le sentiment, l’imaginaire. Je ne me fiais autrefois qu'à mon mental au lieu de faire confiance à cet "autre chose". L’Ikebana m’a aidée en cela. Ceci dit, le travail réflexif est une dimension même de la poésie : la poésie n’est ni propédeutique à la philosophie, ni domaine de l’illusion comme le prétendait Platon, mais lieu d’exercice d’un travail sur la langue, sur le signe. Une démarche critique s'y incarne comme par exemple dans le travail d’un Philippe Beck. Il faudrait croiser les pratiques et lire la philosophie comme on lit un poème, avec l’antenne du coeur, avec le sens de la magie des mots. Le reflet de la lune sur l’étang GB : C’est Nietzsche, je crois, qui parlait des "tard venus de tous les temps". Est-ce que tout a été dit ? Chacun a sa pierre à apporter, en particulier en poésie. Si tout a été dit, chaque poète le redit, ou le recrée de manière unique, invente une sémantique nouvelle. Je pense à cette image zen des reflets de la lune sur l’étang qui ne sont jamais les mêmes alors que la lune est Une. Le reflet varie selon la qualité de l’étang, sa profondeur, son agitation, ses remous, son calme, sa couleur, sa saison, son histoire… La question est de savoir si l’écriture reflète la lune dans son universalité, dans sa dimension cosmique et son absolu ou si elle, l’écriture, reste enfermée dans l’étang ! Parfois, je me dis que j'écris toujours la même chose. Peut-être n'ai-je qu'une chose à dire, quelque chose qui m’habite et ressort quel que soit l'argument : ce serait la notion d'autre côté du visible, la rencontre de l’autre, l’identité végétale, l’attente ; rester dans l’inconfort de la césure qui sépare le dit du silence ; faire éclater le mot comme un noyau nucléaire ; se confier au souffle qui réunifie les deux versants. Mais avoir le même objet de recherche, c’est un peu comme une quête du Graal. J’ai toujours été fasciné par l’obstination de Cézanne à essayer de "saisir" la vérité de la Sainte Victoire et à s’installer inlassablement devant cette paroi levée vers le ciel – jusqu’à ce que mort s’ensuive. Orient, occident GB : Ma démarche en écriture est marquée par toutes les rencontres du chemin - comme une nourriture que l’on assimile et transforme. Un grand moment a été ma lecture de François Cheng autour du dialogue entre Orient et Occident. Après avoir fait de la philo, j'ai essayé de basculer ce rocher trop encombrant. Et lui m'a dit : non, on ne jette rien, on prend tout ensemble. Il n'y a pas d'opposition entre Occident et Orient, ni dualité. La force de la pensée occidentale, c’est le 2, la séparation du sujet et de l’objet, l’unicité du sujet pensant et du sujet de droit. La force de la pensée orientale c’est le 3, la triade cosmique Ciel / Homme / Terre, la reliance, l’interaction. La dimension esthétique GB : Vivre en poésie, c'est à l'état d'intention, c'est un horizon. Je peux paraître attachée à un côté formel (l’importance d’une lampe, d’une bougie, d’une fleur, de la qualité d’un bol), mais c’est une attitude qui n’est pas qu'esthétique. C’est ce désir farouche de rendre la vie belle. La Beauté au sens de François Cheng, c’est celle qui a à voir avec l'âme. La beauté extérieure est donnée en plus, mais ce n'est pas le but. La démarche rappelle l’Ikebana : aller à la rencontre de la saison, de la branche, de sa résistance, de son désir, du surgissement du printemps, offrir ce bouquet à l'autre qui arrive. Si la démarche est juste, sincère... et persévérante, alors la beauté se manifeste, mais elle n’est pas le but. Sinon elle n’est que forme plastique vide. De même dans le haïku, on ne peut pas, à mon sens, faire de recherche esthétique, il n’y a pas la place en 17 syllabes ! Ce qui est beau, c'est le surgissement, l’adéquation du mot et de l’instant. Fili : Certains mots forment des noyaux de sens et d’énergie ? G.B. : Il y a pour moi des mots clefs : beauté, utopie, silence, vide médian, âme. La beauté, celle dont parle Dostoïevski quand il dit "qu’elle sauvera le monde", n’est pas dans les apparences, ni dans l’avoir mais dans l’Être, dans le dévoilement de la Réalité, dans la fissure de l’évènementiel. Elle est en résonance avec l’âme. Dans sa 3ème méditation sur la beauté, F. Cheng cite J. de Bourbon Musset : "L’âme est la basse continue de chaque être, cette musique rythmique, presque à l’unisson du battement de coeur, que chacun porte en soi depuis sa naissance. Elle se situe à un niveau plus intime, plus profond que la conscience... parfois étouffée, jamais interrompue…" Vivre en poésie, serait entrer en connexion avec cette basse continue, écrire serait faire résonner ce chant archaïque et originaire en amont du langage. Ma "vérité commune" Fili : L’écriture est-elle d'abord tournée vers soi ? GB : Elle est toujours quelque part tournée vers l’autre. Mes premiers écrits sont souvent nés d'une lettre. Il y a une adresse dans la plupart des poèmes de Saisons vives. Maintenant, je n'écris plus à quelqu'un en particulier, mais suis toujours dans une relation. J'ai un cahier où s'accumulent des dates, des évènements, des personnes, des notes de lecture. Et soudain, à la relecture, un passage me frappe : tiens, j'ai écrit cela, comme si c'était quelqu'un d'autre qui avait écrit. C'est ma "vérité commune", en relation avec les saisons, la vie humaine autant que végétale. La naissance de ma fille, la mort de mon père, d'autres deuils, les séparations… cela fait partie de cette "vérité commune".
Les compagnonnages G.B. Il y a en eu de nombreux, des livres, des rencontres, des revues. Une fois accepté et reconnu comme personnel - "la vérité est personnelle" dit Char - le mot de poésie m'a ouvert un continent neuf. Il y a eu Jean-Luc Pouliquen qui m’a donné des conseils, des adresses, Jean Bouhier qui m’a fait découvrir l’école de Rochefort – en particulier René Guy Cadou : cette poésie de l’humain, de l’intime, de la liberté. J. Bouhier a préfacé mon premier recueil et fait avancer mon exigence en écriture. Il y a eu Christian Bobin et son Huitième jour de la semaine. Il est l'un des rares auteurs homme à parler de la relation à l’enfant et à s’en nourrir. Ses écrits ont accompagné l’écriture de Elles et de L’enfance à venir, recueils qui ont une dimension autobiographique. Il m’a d’ail-leurs envoyé une très belle lettre en 1996 en réponse à Elles : "… Ces mots sont comme une aide pour un deuil, celui de la fusion, un deuil éclatant, blanc comme les fleurs de cerisiers au printemps – une mère qui donne et l’amour et le manque – mais peut-être est-ce donner deux fois la même chose". J’ai aussi découvert la multitude de revues de poésie – c'est-à-dire la poésie vivante, celle qui constitue le "corpus" d’écriture actuel et hérité, dans lequel chaque auteur s’inscrit dans une relation d’interdépendance –. J’ai commencé à publier (Poésie terrestre, Traces, Parterre Verbal, Souffles, dernièrement Autre Sud). J’ai rencontré en 2003, à Marseille, le Scriptorium (Dominique Sorrente) un lieu de rencontre et d’effervescence poétique, de paroles croisées. J’y ai lié des amitiés, fait connaissance de personnalités : André Ughetto, le peintre Laurent Cabrol qui a collaboré à mon recueil Brûlure du silence. Bien d'autres encore… Il y a actuellement l’ouverture vers un travail d’écriture collective – avec deux amies très précieuses : Geneviève Liautard et Béatrice Machet – ce qui engage une réflexion sur la notion d’auteur, de signature, de glissement du sens. Il s’agit d’une véritable "communauté" d’écriture, d’un exercice spirituel au sens des Stoïciens qui répertoriaient l’écriture parmi les pratiques de vie. La revue, un laboratoire Fili : Quelle place Filigranes occupe-t-elle dans ce passage ? GB : Ce qui me plaît ici ce sont les impulsions que donne le thème, c'est la notion de "tous capables", ce côté simple, humble et ambitieux à la fois, confiant dans les capacités de chacun. Il n'y a pas, pendant les séminaires, de prise de pouvoir, mais une circulation de parole et d’écriture, une réelle mise en commun sans surenchère. À Filigranes, on prend les participants là où ils en sont (parfois encore balbutiants) et on leur donne des moyens d’aller un peu plus loin chacun à leur façon. Le côté atelier me plaît. Mon dernier recueil Frontière de l’absence a en partie démarré ici, à Fili, où j’ai proposé le texte Terre étrangère qui a continué à dévider son fil jusqu’à produire un recueil… Les choses sont en travail, en chemin et on les montre ainsi. C'est la différence avec d'autres revues. On pourrait peut-être aller plus loin en ce sens ? Quelques étapes G.B. : Au départ, mon écriture était plus réservée, plus descriptive, timide. Peu à peu je me suis engagée personnellement… pour ensuite, d’une certaine façon, me "dégager" vers un travail sur la langue. Avec la pratique, l’écriture est devenue plus rapide : moins d’étapes et strates préparatoires, même s’il y a toujours besoin d’un temps de latence, de mûrissement. La matière première de mes textes, je la puise dans mon journal. Il y a souvent une résistance : celle de la langue ou du monde, ou de soi dans le monde. C'est comme les fleurs, on ne peut pas les changer de direction sinon elles cassent. La branche guide vers le bouquet. Le blocage ne vient pas de la nature, mais de soi. Le texte est sans cesse en mutation, sans cesse inachevé, jusqu’à cette joie physique qui parfois est donnée quand il y a coïncidence entre l’intérieur et l’extérieur du mot. Pourquoi publier ? GB : L'édition n'est pas secon-daire même si elle vient après. Elle implique une circulation, une objectivation. C’est l’aboutissement de cette démarche vers l’autre. C’est aussi une forme de reconnaissance. Cela oblige à mettre un point final. Ce qui est dit n’est plus à dire ! Même si j’enrage souvent, mon crayon à la main, devant un texte imprimé de ne pouvoir le corriger ou ajuster encore - comme on ajuste deux pièces de bois – tant il est vrai que l’écriture est toujours pour moi en travail. Parfois, l'important c’est que l’objet existe, même sous forme très simplifiée comme dans Encres Vives. Parfois l'exigence de correspondance entre forme et contenu est plus grande. Je pense au très beau travail typographique d’Encre et lumière qui s’accorde avec la matière des haïkus. Avec les éditions Éclat d’encre, outre la qualité du travail réalisé, j’aime la relation avec la responsable Sandrine Fay qui a un vrai désir d’échange et de rencontre avec ses auteurs. Le fait d’éditer oblige à aller le plus loin possible, là où l'écriture est le plus aboutie. On prend un risque. De même en Ikebana, on distingue les bou-quets d'études réalisés pendant le cours et les bouquets d'exposition pour lesquels on utilise des vases plus raffinés qui gardent la mémoire du Beau. On est là dans une sphère plus créative et plus mystérieuse avec le désir de transmettre au visiteur un peu de cette émotion première, de ce lien avec le secret intime de l’univers. Le passage à l'oralité Fili : Quel rôle les lectures en public jouent-elles dans ta démarche ? G.B. : Alors là ! On entre dans un autre continent, on double le risque pris dans l’édition. J’ai pris progressivement conscience que la lecture à voix haute fait partie intégrante du poème et cela grâce en partie à l’influence du courant contemporain de la poésie orale. Le texte seulement écrit est comme un coeur qui ne fonctionnerait qu’en systole sans diastole. Là encore le travail est de l’ordre de l’intime et non d’un apprentissage théâtral. La voix ose maintenant se livrer mais c’est pour moi un territoire mal exploré, voire encore hostile, et chaque intervention en public représente une hémorragie d’énergie. J’ai livré cette sensation dans le texte Voix incandescente (Filigranes 67) : "Voix toujours nue / qui transgresse la pudeur du silence / laisse échapper le désir de l’autre / bascule dans le vertige du vide / se blesse à l’oreille sourde / se fait frôlement d’aile / à la jointure de l’âme et du corps". "Écrire pour conjurer l'obscurité du monde", dis-tu… G.B. : C'est un des sens donné à l’écriture, que ce soit à un niveau personnel où il est parfois question de survie, conjurer sa propre obscurité - ou à un niveau plus général avec une dimension cathartique, de purification. C’est comme la respiration : l’inspir est dans la réceptivité, l'expir élimine, vide. En ce sens, l’écriture est vitale.Il s'agit de recevoir des souffrances, des émotions et de les dissoudre. L’écriture a à voir avec la prière : elle a une dimension verticale. Il y a dans l’être humain l'horizontalité de la relation à l'autre et la verticalité qui va vers le côté absolu. On vit souvent d'une manière séparée de sa vérité profonde. Cette présence est à l'intérieur de soi, mais on se disperse sans cesse, on se décentre. Par l’écriture, nous nous "coaptons", nous réunissons deux éléments séparés, comme si nous ajustions les bords d'une plaie. Se réunifier, retrouver sa respiration, relier (religion) l'intérieur et l'extérieur : on retrouve là l’enseignement de Maître Ueshiba, le fondateur de l’aïkido : "Se servir de la sincérité du souffle comme d’une épée". On en revient à la conjuration des démons. La dimension sabbatique de l’écriture Fili : Vivre une vie professionnelle, familiale, sociale, s’occuper d’une maison, d’un jardin et écrire : comment tout concilier ? GB : Ce dilemme m'a amenée à forger le concept de "lunditude". Le lundi, dans mon emploi du temps, c'est la journée consacrée à l’écriture, c’est une zone sacrée qu’il faut sauve-garder comme telle. J'ai découvert ainsi la notion de sabbat, sa vérité, sa sagesse. S’obliger à cesser tous gestes quotidiens, c'est fondamental pour entrer dans une relation soit religieuse, soit d'écriture. Il ne s’agit pas seulement de cesser tout travail pour se reposer en Dieu, pour entrer dans un autre temps - celui de l’offrande -, mais de bannir par là même les angoisses et les oppressions intérieures – autrement dit, de se mettre en condition de créativité vraie. Si on veut aller plus loin que panser ses souffrances, il faut laisser place à la disponibilité intérieure, au "vide sabbatique". Passer du temps profane au temps créatif. En lunditude, "terre équivoque où advient l’écriture", on est bien dans l’avènement et non l’événement. On se défait des vêtements quotidiens, on délace ses chaussures comme à l’entrée d’un dojo, on secoue sa poussière, on est dans la notion de conscience au sens Zen du mot. On pénètre dans une autre dimension du langage. La lunditude serait "l’arrière pays" (Yves Bonnefoy), là où "l’invisible et le proche se confondent" ; "l’arrière monde" (Bernard Noël), ce "point où l’espace entre en fusion avec nous-mêmes et s’allège en nous allégeant" ; l’émergence de la "nue présence" (Maldiney), cette fissure le long de laquelle remonte le fond du monde, "présence d’absence" qui n’est autre que le vide médian. À cette heure, pour moi, la poésie est utopie au sens de Maria Zambrano : "J’entends par Utopie la beauté irrésistible, aussi l’épée d’un ange qui nous pousse vers ce que nous savons impossible". Entretien mené par Odette et Michel Neumayer
Geneviève Bertrand a publié...
Cet entretien a été réalisé |
||
|
|
||
|
|
||
|
|
|
|