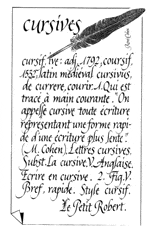"Écrire…
une vie en plus" Lucile Bordes, née en 1971 dans le Var, vit à
La Seyne-sur-mer. . La venue à l'écriture
Lucile : En fait je suis revenue à
l'écriture ! Je m'étais arrêtée quand j'avais commencé à enseigner en lycée et à analyser les textes des autres. Ensuite j'ai enseigné à l'Université, donc d'autant plus experte en analyse et d'autant plus empêchée en écriture. Même maintenant il m'est difficile de faire cohabiter les deux et de me dire : « Ce matin j'écris et cet après-midi je prépare mes cours ou je fais de la recherche. » J'ai beaucoup de mal à passer d'une posture à l'autre, ce sont deux modes de fonctionnement et de réflexion différents pour moi. Pendant cet atelier je me suis mise à écrire pour moi, et grâce à lui j'ai réussi à mettre un point final, c'était la première fois que j'écrivais une forme longue, un roman, qui n'était pas La Marquise de Carabas. Avant d'être enseignante, j'écrivais des récits brefs, de la poésie, toujours des formes qui correspondaient à des émotions ou des instants que j'essayais d'attraper, je n'étais pas dans la construction narrative. Avec l'atelier d'écriture je me suis rendu compte que j'avais des choses à raconter qui pouvaient intéresser et que j'avais des facilités à placer ma voix, à choisir mes mots (dans le texte, pas à l'oral) et je me suis dit que c'était là, pas loin, que je ne devais pas le laisser, l'oublier de nouveau. Filigranes : Qu'enseignes-tu ? Lucile : J'enseigne la langue française et la stylistique, donc vraiment l'étude des textes littéraires, et je ne suis pas sûre que ce soit un plus pour être auteur. On sait que les choses ont été dites, et du coup on arrive assez facilement à relativiser ce qu'on écrit. C'est dur de quitter ce rôle de censeur. Il me faut à chaque fois une déprise de ce savoir-là pour me mettre dans l'écriture sans me poser de questions parasites. Filigranes : Après ce congé, comment as-tu fait concrètement pour continuer à trouver du temps pour l'écriture ? Lucile : Je me suis mise à temps partiel : écrire était devenu très important, sinon j'aurais été malheureuse, vraiment. J'ai écrit Je suis la marquise de Carabas lorsque je travaillais à temps partiel, Décorama dans les intervalles de la vie universitaire en y consacrant par exemple certaines vacances ou certaines journées (je m'abstrais alors de tout le reste une journée par semaine). Je suis en train de m'organiser pour trouver du temps pour le troisième.
Écrire, c'est avoir prise sur le réel
Filigranes : Quand tu écris, tu arrives à écrire un jour et à reprendre une semaine après ? Lucile : Idéalement, j'y arrive dans un premier temps, quand je me dis que j'ai envie d'écrire sur « ça ». Alors j'écris des petits bouts de textes, à la main, pas sur l'ordi. J'écris parfois une scène, parfois deux mots qui me semblent caractériser quelque chose. Là, ce peut être très dé-cousu. Mais à partir du moment où j'entre dans la rédaction, j'ai besoin de temps devant moi, ce temps
d'écriture est contraignant et peut faire concurrence avec le travail à l'université, avec la vie de famille... tout devient moins important d'un coup. En fait l'écriture est un peu addictive : tu peux être sevré pendant de longues années, comme je l'ai été, et quand tu commences, tu ressens que la vie est plus riche et plus excitante. L'écriture n'enrichit pas ta vie, mais tu en as une en plus, il est difficile ensuite d'y renoncer ! Ce n'est pas en termes de « vide », de « vacance » : tout se passe au contraire comme si la vie s'était resserrée, et toi tu vas devoir l'écarter pour faire de la place à cette vie en plus. Filigranes : D'où penses-tu que te vienne cette envie d'écrire ? Lucile : Il me semble qu'elle vient de la lecture. J'ai eu un vrai choc esthétique dans mon enfance, en CP quand j'apprenais à lire. J'avais le sentiment qu'en maîtrisant les mots je maîtriserais le monde, j'ai donc compris comment ça marchait et j'ai lu d'un coup toute seule, sans rien dire, tout le manuel de lecture. Il y avait plein de textes, parmi eux se trouvait le poème de Verlaine
« Il pleure dans mon cœur... ». Je revois bien la disposition sur la page. Ce fut un gros choc, c'était un trésor, je me suis dit que c'était extraordinaire d'avoir pu écrire cela et je l'ai appris par cœur... Je devais être une petite fille mélancolique ! Je n'ai aucune capacité de mémorisation des poèmes, j'essaie souvent de les apprendre mais je les oublie, sauf celui-là. Le choc a été trop trop grand, je n'en ai plus jamais retenu un en entier !
Tisser le réel et la fiction Filigranes : Quelle différence fais-tu entre le roman et le poème ? Lucile : Le roman permet de réécrire le monde pas nécessairement tel qu'il est. Je savais grâce à la forme brève que je peux écrire le réel, mais cette écriture-là est pour moi très exigeante, condensée, et je ne me sens pas vraiment libre d'inventer. Dans le roman, je voyais une forme de liberté, la possibilité d'introduire un personnage, de la fiction. Filigranes : Malgré tout, on peut se poser la question de la part du fictionnel et de celle de l'autobiographie dans "Je suis la Marquise de Carabas". Lucile : Le point de départ existe vraiment : j'ai enregistré mon grand-père me parlant du théâtre Pitou. La partie en je/tu est plutôt biographique, même si on se permet de réaménager la réalité ; celle à la troisième personne, plus épique, correspond à une écriture dans les trous du récit enregistré. Mon grand-père se rappelait des éléments qui étaient déjà du discours rapporté de son propre grand-père... j'ai imaginé tout ce qui manquait.
Filigranes : Et pour Décorama, le réel de départ, c'était le cimetière ? Lucile : Je savais que j'allais écrire sur cet endroit, l'ancien logement de fonction du gardien du cimetière. En fait, j'étais comme Georges, le héros : je passais devant quand j'allais au lycée et je me demandais comment quelqu'un pouvait vivre là, à la frontière entre morts et vivants ! Et quels vivants : des gamins braillant en se rendant en cours de sport ! Lui se tenait entre l'espace du cimetière et la route passante. Que quelqu'un vive là me semblait improbable. Je suis partie de cette question : Qui peut bien vivre là ? Je ne l'ai jamais rencontré, j'ai failli lui offrir un exemplaire mais j'ai trouvé cela prétentieux ; il risquait de mal le prendre, je me suis abstenue. Donc pour moi, celui qui vit à cet endroit-là, finalement c'est Georges, avec cette histoire-là. Le roman sert à répondre à cette question. Pour La Marquise, la question était : Pourquoi mon grand-père n'a-t-il pas raconté cette histoire plus tôt ? Pourquoi a-t-il tu cela ? Pourquoi ma mère et ses sœurs ont-elles absorbé ce silence ? J'ai imaginé une réponse à cette question : pour lui, il s'agissait d'un exil, et comme tous les exilés, il préfère ne pas en parler parce que c'est trop douloureux. Ce ne sera donc pas lui qui mettra les mots, mais la génération suivante, ou celle d'après... C'est ma réponse, ce n'est peut-être pas la sienne. Filigranes : La réponse que tu donnes dans le livre est que lui n'a pas su faire vivre ce théâtre de marionnettes. Lucile : J'imagine en effet un sentiment de culpabilité. Il est tombé au mauvais moment, il n'a pas su le faire vivre, n'a pas su garder le cinéma ensuite. J'imagine un homme qui a fait avec cette douleur-là, celle de ne plus appartenir au monde de ses parents. Voilà pourquoi je parle d'exil, et Georges, dans son genre, est aussi un exilé. Filigranes : Donc tu construis des mondes en mutation, et des personnages se tiennent à la frontière, à la charnière de ces deux mondes. Lucile : Ce sont des témoins, des passeurs un peu malgré eux, pas des gens qui ont des facilités à transmettre.
Être ancrée dans un lieu et une culture Filigranes : Un autre point commun entre tes deux romans, Lucile : Je viens de là, en fait, et j'écris avec ce que je connais. Pour moi c'est une culture et un rapport au monde particuliers. Je les ai souvent aimés ou critiqués. Dans ce milieu on trouve une liberté de langage intéressante, de l'invention dans les mots. Le rapport au monde et au lieu est ce qu'il y a de plus intime et c'est ce qui me touche chez les auteurs. Pierre Magnan, par exemple, est du côté du conte, il emploie le « nous ». Sa posture de parole m'intéresse : parler depuis une communauté qu'on met en scène, qu'on ouvre à d'autres et à laquelle on rend hommage finalement. Filigranes : Tu es sensible à la dimension de l'oralité, Lucile : Étrangement, quand j'écris, la langue qui m'aide beaucoup aussi est celle de Michaux que je relis souvent. Sa liberté lexicale, rythmique, est extraordinaire. Par exemple, dans Voyage en grande Garabagne et Au pays de la magie, Michaux liste des créatures et des métiers imaginaires, l'un d'entre eux, c'est le poseur de deuil … Commençant à écrire Décorama, à réfléchir sur le personnage, j'ai dû relire Michaux. Ces auteurs ne m'aident pas forcément sur le plan thématique, mais pour leur rapport à la langue. Enfin, chez Liana Levi il y a une auteure que j'aime bien, c'est Milena Agus. Elle est sarde, parle le sarde, et écrit de courts romans dont les histoires, extraordinaires pour moi, se déroulent dans le milieu qu'elle connaît, où s'articulent le singulier et l'universel.
Parler avec peu de mots Filigranes : Est-ce que tu vois une évolution de ton écriture Lucile : Il y a ce que j'apprends en réécrivant, et ce que l'ouvrage précédent induit sur le suivant. Pour La marquise de Carabas, j'avais une construction par tableaux ; je savais quelles scènes j'allais y introduire, et entre deux scènes c'était comme un chemin à parcourir, un gué. C'était rassurant, et en même temps j'avais la liberté : je ramenais à la « pierre » lorsque je voyais que je m'éloignais trop.
Dans Décorama j'ai voulu moins d'ellipses. On essaie, on a besoin de faire des choix différents. Il y a ce qu'on apprend dans la mesure où plus on écrit et réécrit, plus on affine son écriture. Filigranes : On verrait bien que ce soit publié dans des journaux comme au XIXe, avec « à suivre » ! Lucile : Venant de la « forme brève » et ayant besoin d'un certain silence dans le texte, j'ai beaucoup de mal à lire les romans où il y a trop de mots. Le découpage en chapitres me permet d'introduire un peu de silence. Quant aux ellipses, elles ne sont pas volontaires. Soit les éléments ne me semblent pas dignes d'intérêt, soit je préfère laisser le lecteur rêver sur ce qui s'est passé entre deux phrases, deux chapitres... et parfois, a posteriori, valider ou invalider ce qu'il a rêvé. Je fais assez confiance au lecteur pour combler ou pas les ellipses, mais certains lecteurs n'aiment pas. Certains m'ont dit qu'ils avaient beaucoup aimé La Marquise mais qu'il n'était pas possible de faire disparaître un personnage en 4 mots ! Ils étaient frustrés ! Mais moi je trouve bien aussi de frustrer le lecteur, pour qu'il reste dans le désir !
Entre laisser venir et planifier Filigranes : Et pour ton troisième roman, que vas-tu expérimenter ? Lucile : Je n'avais pas du tout arrêté de plan pour Décorama. J'étais partie du lieu et n'avais pas projeté mon récit... ce qui rend prisonnier des mots. Filigranes : Les marionnettistes créent leur monde tels des dieux, et en même temps, aussi habiles soient-ils, ça leur échappe malgré tout. Ils animent, mais la marionnette parle au-delà d'eux. Lucile : Souvent j'ai l'impression que tout est extrêmement fragile. J'avance sur un fil, je ne suis pas marionnettiste mais funambule. Heureusement il y a l'idée de départ, à quoi tu peux revenir quand tu sens que ça peine, tu peux alors revenir à cette intention-là.
La voix du conteur Filigranes : Le théâtre de marionnettes pour "Je suis la Marquise de Carabas"… Lucile : Décorama, le roman ne s'intitulait pas ainsi au départ. L'idée du titre est venue parce que le personnage se revoit en train de jouer avec ses Indiens. Après coup je me suis dit qu'effectivement il vit dans un décorama. On a choisi ce titre in extremis. Il m'est apparu que ce qui compte est le lieu, les personnages sont de passage, le lieu se modifie... Le personnage principal veut en garder une image idéale qui ne correspond pas avec la réalité. Je n'avais pas fait le rapprochement avec le décor de marionnettes, mais maintenant c'est évident. Filigranes : Une mise en abyme du spectacle vivant... Lucile : C'est peut-être parce qu'en fait je n'écris pas un roman mais raconte une histoire. Dans ma tête c'est un conteur qui conte - je commence par dire où ça se passe - les personnages apparaissent progressivement. L'amorce est ténue, c'est le point de vue de quelqu'un sur quelque chose. Ensuite tu donnes une voix à ces personnages, tu les entends, ils ne peuvent plus dire et faire n'importe quoi. Filigranes : Ton histoire viendrait des mots que tu choisis ? Lucile : Beaucoup. Le cliché "le personnage m'a échappé" ne m'a jamais paru très crédible, surtout en tant que linguiste. Ce ne sont pas les personnages qui échappent, c'est la matière qui commande. En écrivant des formes longues (je ne l'avais pas senti pour les formes brèves), j'ai découvert que les mots et le rythme commandent jusqu'à des choix d'intrigue ou de caractérisation des personnages. La matière résiste, a son épaisseur. Même si on sait où on va, on n'y va pas forcément par le chemin prévu.
La réécriture Filigranes : Le premier roman que tu as écrit pendant ton année de congé, Lucile : Non, je l'ai envoyé chez Liana Levi et d'autres éditeurs aussi. J'ai reçu des réponses type et deux réponses non type qui s'annulaient ! L'une disait que l'histoire était géniale mais le style trivial ; l'autre que le style était extraordinaire, mais l'histoire banale… Filigranes : Comment procède Liana ? Elle te fait des remarques précises Lucile : Liana fait des remarques sur les passages qu'elle aime, ou aime moins, cela reste indicatif et général. Le vrai travail, je le fais avec celle qui est mon éditrice, Sandrine Thévenet et qui est ma lectrice idéale.
La rencontre des lecteurs Filigranes : Et que se passe-t-il lorsque tu rencontres les lecteurs ? Lucile : Certains lecteurs ont enrichi la vision de mon texte ; d'autres ont fait leur propre texte, ce qui peut être déroutant ! Ce qui est dur aussi, c'est que les gens te voient comme un auteur. Je pensais que c'était le livre qui faisait sa vie, mais j'ai appris qu'il y avait la période de promotion où on accompagne le livre, ce qui signifie s'exposer, soi. Devenir une personne publique, même dans la toute petite mesure d'un premier roman, c'est particulier. On découvre un monde médiatique, dans lequel un article en amène un autre. Je ne soupçonnais pas que je devrais parler de moi, je ne pensais pas m'exposer autant, me retrouver sur une avant-scène. Je ne l'avais jamais vécu : face à un amphi, à la fac, je ne parle pas de moi. Filigranes : Qu'attendent les lecteurs de ces rencontres ? Lucile : La plupart du temps ils attendent de te dire qu'ils ont aimé le livre, les gens sont extrêmement bienveillants. Du coup ils sont curieux de toi, ils veulent savoir comment tu l'as écrit, combien de temps tu as mis, si tu vas en écrire un autre. Ils veulent te dire ce qui leur a plu.
Devenir auteur Filigranes : Parlons de tes autres activités. Quelles différences, Lucile : Pour moi ça n'a rien à voir. Écrire sur les mots des autres… Je suis linguiste, je ne peux pas me permettre d'en dire n'importe quoi. Je suis dans la maîtrise. Je mobilise des savoirs théoriques. J'analyse. Je vérifie des hypothèses. Je rédige des conclusions. Filigranes : Tu animes à ton tour maintenant des ateliers d'écriture. Lucile : Je les vis comme des choses vraiment différentes. Quand j'anime, j'ai le souci des autres, je mets une autre casquette. Je mets en jeu mes compétences universitaires. Je redeviens analyste, avec des outils propres à la linguistique. Ou alors je fais un travail de lectrice : je fais remarquer un moment fort, je suggère de se laisser aller dans ce passage, ou de laisser tomber quelque chose qui alourdit. Devenir le lecteur de son propre texte, ce n'est pas facile. Chaque personne a sa limite, son seuil de réécriture. Ceci dit, l'enjeu en atelier et dans la publication n'est pas le même. Certains écrivants réussissent de beaux textes, mais ce ne sont pas des auteurs. Filigranes : Qu'est-ce qui fait qu'on est un auteur, alors ? Lucile : C'est qu'on accepte d'être publié, clairement. Pour être un auteur il faut en avoir envie. Une année, j'ai mené un atelier d'écriture incluant un projet de publication, c'était presque du coaching. Ce fut une expérience très intéressante. Les personnes arrivaient avec un projet d'écriture, je ne les lâchais pas, je les amenais au point final, c'était super. Ils étaient quatre, très contents. Mais aucun n'a envoyé son texte à des éditeurs, n'a accepté d'être jugé par un anonyme pas nécessairement bienveillant avec le risque que le projet lui échappe. Maintenant je sais quelle est la différence entre quelqu'un qui réussit un texte et un auteur : c'est la démarche particulière de la publication.
Entretien réalisé et mis en forme
|
Lucile Bordes évoque aussi
|
|